|
EN BREF
|
L’optimisation du stockage d’énergie est devenue une priorité essentielle dans le cadre de l’expansion des énergies renouvelables. Alors que des technologies telles que le solaire et l’éolien continuent de se développer rapidement, elles introduisent de nouveaux défis liés à la variabilité et à la gestion de l’approvisionnement en énergie. Dans ce contexte, les solutions de stockage sont indispensables pour assurer un équilibre entre production et consommation, afin de garantir une utilisation efficace des ressources. En explorant des approches innovantes pour le stockage d’énergie, l’Institut Français du Pétrole Énergies Nouvelles (IFPEN) joue un rôle clé dans la transition énergétique, en contribuant à rendre nos systèmes énergétiques plus résilients et durables.

Le stockage d’électricité
Le stockage d’électricité est essentiel pour optimiser l’utilisation des énergies renouvelables, particulièrement celles qui dépendent des conditions météorologiques, telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne. En effet, la production d’électricité à partir de ces sources est souvent variable et non pilotable, nécessitant des systèmes de stockage pour garantir un équilibre entre production et consommation. Ce besoin a conduit à un développement rapide et diversifié des technologies de stockage, allant des systèmes de stockage stationnaire, utilisés pour lisser la production et faire face aux pics de demande, aux batteries pour des applications mobiles ou locales.
Pour illustrer cette dynamique, prenons l’exemple des stations de transfert d’énergie par pompage, qui sont des installations hydrauliques capables de stocker l’électricité en pompant de l’eau vers un réservoir supérieur lorsque la production est excédentaire. Lorsque la demande augmente, l’eau est relâchée pour faire tourner des turbines et produire de l’électricité. À l’échelle mondiale, les stations de pompage représentent environ 97 % des capacités de stockage connectées, mettant en avant leur rôle crucial dans le système énergétique. D’autres systèmes, comme le stockage par air comprimé ou les batteries électrochimiques, offrent également des solutions adaptées aux différents besoins de stockage, stimulant encore l’innovation dans ce secteur vital.

Le stockage d’électricité
Avec la montée en puissance des énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien, il devient impératif d’augmenter les capacités de stockage d’électricité pour compenser leur nature intermittente et décentralisée. Environ 180 GW de stockage stationnaire sont actuellement déployés à l’échelle mondiale, représentant à peine 3 % de la capacité électrique installée. Pour mettre en perspective ces chiffres, la capacité éolienne mondiale a atteint plus de 651 GW en 2020. Bien que le stockage d’énergie soit crucial pour équilibrer l’offre et la demande, de nombreux défis techniques, réglementaires et économiques subsistent, entravant l’adoption à grande échelle de solutions innovantes.
Les systèmes de stockage peuvent être classés en deux catégories principales : le stockage stationnaire, vital pour l’équilibre du réseau électrique, et le stockage embarqué, couramment utilisé dans les appareils portables et les véhicules électriques. Par exemple, le stockage stationnaire non seulement atténue la variabilité des énergies renouvelables mais contribue également à répondre aux exigences de pics de consommation, qu’il s’agisse de journées ensoleillées ou d’hivers rigoureux. En parallèle, le stockage embarqué, avec des applications dans les véhicules électriques, représente une avancée significative vers une transition énergétique durable.
Le stockage mécanique
Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP)
Les STEP exploitent un principe simple de gravité et sont responsables de près de 97 % de la capacité de stockage d’électricité à l’échelle globale. En pompant de l’eau vers un réservoir supérieur pendant des périodes de surplus énergétique, ce système peut ensuite générer de l’électricité en laissant l’eau redescendre par gravité pendant des périodes de forte demande. Bien que leur efficacité soit avérée, leur mise en œuvre nécessite des investissements considérables et dépend de conditions géographiques spécifiques.
Les avantages de la STEP vont au-delà du simple stockage : elles permettent également d’optimiser l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Par exemple, la centrale d’El Hierro aux Canaries, qui combine éolien et pompage, représente une solution pionnière en utilisant le surplus d’énergie pour alimenter des turbines hydrauliques, témoignant ainsi de la synergie entre différentes sources d’énergie.
Le stockage par air comprimé
Le CAES est une technologie moins courante, qui compresse l’air à haute pression pour le stocker. Bien que des installations comme celle de Huntorf en Allemagne montrent son potentiel, ce système souffre d’une faible efficacité due aux pertes de chaleur. Des innovations en matière de stockage adiabatique pourraient, cependant, améliorer ces rendements en permettant de stocker la chaleur générée lors de la compression.
Le stockage électrochimique : les batteries
Les batteries, représentant un segment en pleine expansion dans le domaine du stockage d’énergie, répondent à une variété de besoins allant des appareils électroniques aux véhicules électriques, et sont également intégrées dans des systèmes de stockage stationnaire. Le projet de Tesla en Australie avec un système de 100 MW souligne l’importance croissante de ces technologies dans la stabilisation des réseaux. Les batteries lithium-ion, bien que dominantes, font face à une concurrence croissante de nouvelles technologies telles que les batteries sodium-soufre et sodium-ion qui pourraient offrir des alternatives sur le long terme.
La R&D des batteries à flux, qui utilisent des électrolytes circulant à travers une cellule, montre également un potentiel majeur, surtout pour les applications de stockage à long terme, permettant d’adapter les solutions selon les besoins précis des utilisateurs. Leur modularité et leur capacité à gérer de grandes quantités d’énergie les rendent prometteuses pour l’avenir du stockage d’énergie.
Le stockage chimique : l’hydrogène
La production d’hydrogène par électrolyse, particulièrement à partir de surplus d’électricité renouvelable, représente une voie attrayante pour le stockage d’énergie. Bien que la reconversion de l’hydrogène en électricité via des piles à hydrogène soit encore confrontée à des défis économiques, des projets comme celui de la plateforme expérimentale Myrte en Corse démontrent son potentiel. En stockant de l’hydrogène et en l’utilisant durant les périodes de forte demande, on peut envisager un avenir où l’hydrogène joue un rôle central dans l’alimentation énergétique.
Quel avenir pour le stockage d’électricité ?
Pour que le stockage d’électricité devienne économiquement viable, des avancées dans les processus de fabrication, le développement de nouveaux matériaux, et l’amélioration des performances sont nécessaires. Actuellement, les coûts de stockage varient considérablement selon les technologies, mais de récentes tendances indiquent que des solutions compétitives pourraient émerger dans la décennie à venir, transformant potentiellement le paysage énergétique mondial. Évaluer les implications environnementales et la durabilité de chaque solution sera également fondamental pour guider les choix futurs en matière de politiques énergétiques.
Le stockage thermique
Le stockage thermique joue un rôle essentiel dans la gestion de la consommation énergétique, représentant près de 50 % de la consommation d’énergie en Europe. En récupérant la chaleur disponible lors des périodes ensoleillées pour la réutiliser par la suite, il constitue une approche efficace pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. Les matériaux utilisés pour le stockage de chaleur, tels que l’eau, permettent d’accumuler de la chaleur sensible, tandis que le stockage de chaleur latente repose sur des changements de phase, bien qu’il reste à développer à grande échelle.
De plus, le stockage thermochimique et les systèmes spécialisés dans le stockage de chaleur des centrales solaires thermodynamiques montrent un potentiel considérable pour surmonter les défis de l’intermittence. Les exemples de centrales solaires en Espagne illustrent comment une gestion efficace de la chaleur peut optimiser la production d’électricité, garantissant une alimentations efficace même lorsque le soleil ne brille pas. Cette dynamique de stockage thermique pourrait devenir une clé de voûte dans les systèmes énergétiques futurs, intégrant les énergies renouvelables de manière optimale tout en répondant aux besoins domestiques et industriels.
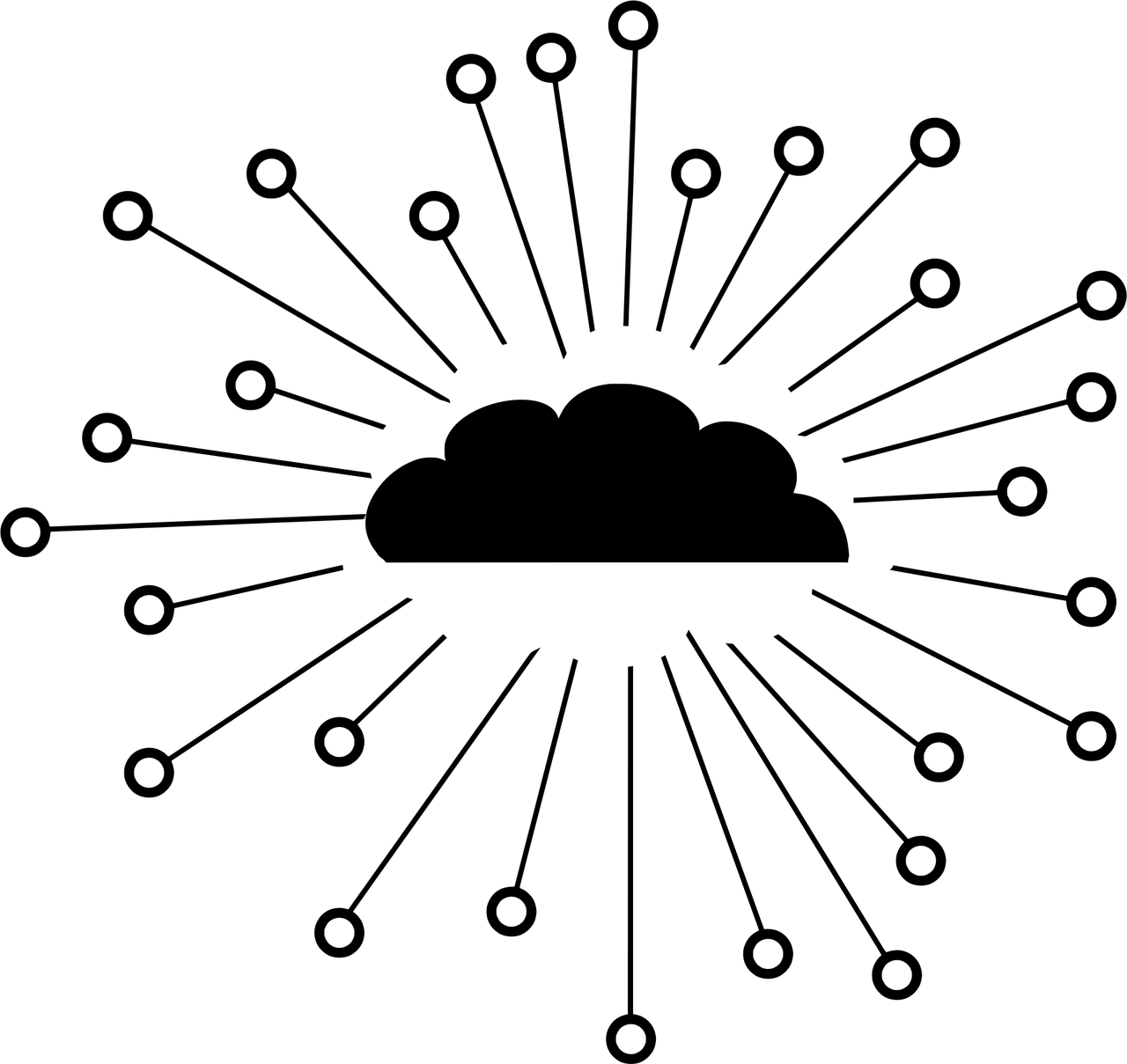
Le stockage d’électricité
Qu’est-ce que le stockage d’électricité ?
Avec l’essor des énergies renouvelables telles que le solaire et l’éolien, il devient crucial d’augmenter les capacités de stockage de l’électricité pour stabiliser l’équilibre entre production et consommation. En raison de la variabilité de ces sources d’énergie, le stockage permet de capitaliser sur les périodes de surplus pour les restituer lors des pics de consommation ou en cas de défaillance du réseau.
Il existe deux catégories principales de systèmes de stockage : le stockage stationnaire qui compose la majorité des installations, et le stockage embarqué, important pour des applications comme les véhicules électriques ou l’électronique portable.
- Stockage stationnaire : fait référence à des installations fournissant de grandes puissances (de quelques kW à plusieurs GW) pour équilibrer la demande.
- Stockage embarqué : commun dans des dispositifs de moindre capacité, comme les batteries de téléphones et les véhicules.
- La technologie de stockage : comprend des systèmes variés comme des batteries, des installations de transfert d’énergie par pompage (STEP) et des solutions à air comprimé.
- Coûts de stockage : actuellement, le coût du stockage s’établit entre 0,11 € pour les STEP et 0,16 à 0,50 € pour les batteries lithium-ion.
Pour connaître plus en détail ces différentes technologies, il est crucial d’observer les dernières avancées et les projets en cours, qui portent une attention particulière à l’optimisation des coûts et à la durabilité des solutions proposées. Par exemple, la centrale de pompage de El Hierro utilise l’énergie éolienne pour alimenter une STEP, démontrant ainsi l’intégration des énergies renouvelables dans le stockage d’énergie.
Le stockage thermique
Une solution pour la consommation énergétique
Le stockage thermique joue un rôle essentiel dans l’usage de la chaleur et du froid dans les bâtiments, représentant ainsi une part significative de la consommation énergétique en Europe. La stratégie consiste à collecter la chaleur lorsqu’elle est disponible (comme durant les heures ensoleillées) pour l’utiliser quand elle est nécessaire.
Parmi les méthodes de stockage thermique, on distingue :
- Chaleur sensible : Peut être stockée sous forme de changement de température, souvent dans de l’eau ou des matériaux robustes.
- Chaleur latente : Utilise les changements de phase (sous forme de solide à liquide) pour le stockage de chaleur, bien que encore à l’état de développement pour les grandes capacités.
- Thermochimique : Via des réactions réversibles adaptées à certaines applications industrielles ou climatisées.
- Centrales solaires thermodynamiques : Utilisant un fluide caloporteur chauffé pour produire de l’électricité pendant les périodes de consommation maximale.
Des projets innovants se développent, comme ceux en Espagne avec des centrales capables de stocker de l’énergie thermique pendant de longues périodes, assurant un approvisionnement régulier même lorsque le soleil ne brille pas.

Le stockage d’électricité
Avec la montée des énergies renouvelables telles que le solaire et l’éolien, dont la production fluctue et est difficilement prévisible, il est impératif d’accroître les capacités de stockage de l’électricité. Cependant, plusieurs défis techniques, réglementaires et économiques entravent l’adoption de nouvelles solutions de stockage. Ainsi, des efforts de recherche se déploient à l’échelle mondiale.
Qu’est-ce que le stockage d’électricité ?
Il est essentiel de différencier deux types de stockage :
- Le stockage stationnaire de l’électricité permet de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité sur les réseaux, en particulier pour compenser la variabilité de la production des énergies renouvelables. Par exemple, l’énergie excédentaire produite durant une journée ensoleillée peut être stockée pour être utilisée en soirée. Ce type de stockage joue également un rôle crucial lors des pics de consommation ou lors de pannes.
- Le stockage embarqué (comme les batteries pour les véhicules ou les appareils portables) se caractérise par une capacité plus limitée, généralement à l’échelle des kWh.
À l’échelle mondiale, les installations de stockage stationnaire représentent environ 180 GW, soit environ 3 % de la capacité installée en électricité. En comparaison, la capacité éolienne totale installée a dépassé 651 GW en 2020.
Par ailleurs, l’énergie électrique ne peut habituellement pas être stockée directement ; elle doit être transformée en une autre forme d’énergie, puis reconvertie en électricité lorsqu’elle est nécessaire.
Le stockage mécanique
Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP)
Ce principe repose sur l’énergie gravitaire et il existe environ 400 STEP dans le monde, dont la majorité se trouvent en Europe. Les STEP représentent 97 % de la capacité de stockage d’électricité connectée mondialement.
Fonctionnement : Ce système, souvent lié à des barrages, utilise deux réserves d’eau à des hauteurs différentes. Lorsque l’électricité excède la demande, l’eau est pompée du bassin inférieur vers le supérieur. Cette eau est ensuite relâchée pour fournir de l’électricité lors des besoins. Cela permet d’associer l’énergie renouvelable avec la flexibilité des systèmes classiques.
Un exemple notable est la centrale de pompage d’El Hierro dans les Canaries.
Le stockage par air comprimé (CAES)
Le stockage par air comprimé, introduit en 1978, se distingue par son rendement d’environ 50 % en raison des pertes de chaleur lors de la compression et de la détente de l’air. Ce système de stockage, basé sur la compression d’air à haute pression, utilise une turbine pour produire de l’électricité lors de la décompression.
Un concept avancé, l’Advanced Adiabatic CAES (AA-CAES), est en cours de développement, visant à récupérer la chaleur émise lors de la compression, augmentant ainsi le rendement à environ 70 %.
Le stockage électrochimique : les batteries
Les batteries, qui répondent à des besoins variés allant de l’électronique à l’autoconsommation, se reconnaissent par leur capacité à délivrer de l’énergie sur plusieurs heures. Leur utilisation croissante dans le secteur résidentiel et les microgrids est significative.
Tesla a récemment lancé, en Australie, un système de stockage d’énergies renouvelables à batterie lithium-ion d’une puissance de 100 MW.
Fonctionnement : Le principe de stockage repose sur des réactions électrochimiques qui transfèrent des ions et des électrons entre deux électrodes. Les batteries lithium-ion, ainsi que celles à sodium et à flux, connaissent un développement prolifique pour répondre aux besoins du marché.
Le stockage chimique : l’hydrogène
En cas de surplus, l’électricité des énergies renouvelables peut être convertie en hydrogène par électrolyse, permettant un stockage et une reconversion ultérieure en électricité via une pile à hydrogène. Le développement de l’hydrogène comme vecteur énergétique de stockage de grande capacité est en cours.
Quel avenir pour le stockage d’électricité ?
Les technologies de stockage actuelles nécessitent des améliorations pour être économiquement compétitives. Les recherches portent sur divers aspects tels que les procédés de fabrication, les matériaux utilisés et l’impact environnemental.
Actuellement, les coûts de stockage pour un kWh d’électricité sont respectivement de 0,11 € pour les STEP, 0,12 € pour les technologies CAES et de 0,16 à 0,50 € pour les batteries lithium-ion, rendant comparativement élevés les coûts au regard de la production électrique classique.
Le stockage thermique
Le stockage thermique s’intéresse particulièrement au chauffage et à la climatisation des bâtiments, représentant près de 50 % de la consommation énergétique en Europe. Il vise à capter la chaleur disponible pour l’utiliser lorsque nécessaire, notamment en hiver.
Des échanges thermiques se produisent via des matériaux variés, que ce soit par la chaleur sensible ou par des réactions chimiques réversibles, permettant un stockage sans perte thermique. De plus, le stockage associé aux centrales solaires thermodynamiques constitue une avenue prometteuse, notamment en Espagne où plusieurs installations majeures opèrent.

Optimiser le stockage d’énergie pour soutenir l’expansion des énergies renouvelables
L’optimisation du stockage d’énergie est essentielle pour accompagner le développement des énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien, dont la production est soumise à des fluctuations. Les systèmes de stockage stationnaire, tels que les stations de transfert d’énergie par pompage et les technologies de stockage par air comprimé, jouent un rôle crucial en équilibrant l’offre et la demande d’électricité. De plus, les avancées dans le domaine des batteries électrochimiques offrent des solutions adaptées pour répondre aux besoins locaux, notamment dans le cadre des microgrids.
Aujourd’hui, la recherche se concentre sur l’amélioration des matériaux et des procédés de fabrication afin d’augmenter l’efficacité et la durabilité du stockage d’énergie. Le stockage ne se limite pas seulement à la gestion des surplus d’électricité, mais il constitue aussi un levier pour réduire l’empreinte carbone et intégrer davantage d’énergies renouvelables dans le mix énergétique. En explorant des options comme le stockage thermique et chimique, nul doute que des solutions innovantes émergeront pour un avenir durable.
À terme, la mise en œuvre de ces systèmes de stockage, couplée à un cadre réglementaire favorable, pourrait transformer les défis énergétiques en opportunités, pave la voie vers une transition énergétique réussie et contribuer significativement à la lutte contre le changement climatique.

